Nolife Story : mes impressions
 5 mai 2012 à Paris, au cinéma Max Linder, 500 personnes assistent à l’avant-première du cinquième épisode de la série culte France Five, attendu depuis plusieurs années. Deux semaines plus tard, le 19 mai 2012 un millier de spectateurs se presse au palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux pour célébrer dans un spectacle de plus de trois heures les cinq ans de la chaîne Nolife. Aux origines de ces deux événements, deux hommes : Sébastien Ruchet et Alex Pilot. Si se lancer dans la réalisation d’une série rendant hommage aux sentaî de notre enfance (série live japonaise comme X-Or ou Bioman pour citer les plus connues) était déjà un pari pour le moins original, enchaîner sur la création d’une chaîne de télé dédiée aux geeks et à la culture japonaise relevait du rêve de doux dingues. Pourtant, malgré les difficultés énormes, l’inexpérience, la malchance, mais grâce au travail hallucinant d’obstination d’une équipe de passionnés, Nolife a traversé bien des périls pour se hisser aujourd’hui comme emblème de bien des geeks et otakus de France et de Navarre. Au travers de son ouvrage « Nolife Story », Florent Gorges, qui parallèlement à sa biographie de Yoshihisa Kishimoto (dont vous pouvez retrouver un excellent article par ici) semble avoir découvert le moyen de mettre trente-six heures dans une journée, nous permet de revenir sur les grands moments et les petites anecdotes de cette aventure télévisuelle, mais surtout, incroyablement humaine.
5 mai 2012 à Paris, au cinéma Max Linder, 500 personnes assistent à l’avant-première du cinquième épisode de la série culte France Five, attendu depuis plusieurs années. Deux semaines plus tard, le 19 mai 2012 un millier de spectateurs se presse au palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux pour célébrer dans un spectacle de plus de trois heures les cinq ans de la chaîne Nolife. Aux origines de ces deux événements, deux hommes : Sébastien Ruchet et Alex Pilot. Si se lancer dans la réalisation d’une série rendant hommage aux sentaî de notre enfance (série live japonaise comme X-Or ou Bioman pour citer les plus connues) était déjà un pari pour le moins original, enchaîner sur la création d’une chaîne de télé dédiée aux geeks et à la culture japonaise relevait du rêve de doux dingues. Pourtant, malgré les difficultés énormes, l’inexpérience, la malchance, mais grâce au travail hallucinant d’obstination d’une équipe de passionnés, Nolife a traversé bien des périls pour se hisser aujourd’hui comme emblème de bien des geeks et otakus de France et de Navarre. Au travers de son ouvrage « Nolife Story », Florent Gorges, qui parallèlement à sa biographie de Yoshihisa Kishimoto (dont vous pouvez retrouver un excellent article par ici) semble avoir découvert le moyen de mettre trente-six heures dans une journée, nous permet de revenir sur les grands moments et les petites anecdotes de cette aventure télévisuelle, mais surtout, incroyablement humaine.
Tout d’abord, si vous êtes en train de lire ces lignes, trois cas de figure se présentent :
-
Vous ne connaissez pas Nolife, bien que cela vous dise peut-être vaguement quelque chose. Dans ce cas, restez avec moi, je m’en vais vous présenter rapidement cette formidable petite chaîne.
-
Vous connaissez déjà Nolife, et même plutôt bien. Dans ce cas, comme je sais que vous êtes des gens très occupés, je vous fais grâce de la lecture de la première partie de cet article et vous retrouve donc à la suivante. En attendant que je finisse la visite avec les noobs du 1), je vous invite à patienter en sirotant un soda bien frais ou un café et, pourquoi pas, en visionnant une ou deux des vidéos gratuitement mises en ligne sur Nolife Online.
-
Vous adorez mes articles et n’en loupez un sous aucun prétexte … Comme vous y allez, vous me gênez ! Je vous en prie ! Non ! Vous d’abord… Mais enfin ! Excusez-moi, veuillez me lâcher la jambe, j’ai un texte à écrire.

Bon, Nolife, c’est quoi ?
C’est une chaîne émettant depuis juin 2007 sur les réseaux de télévision ADSL (d’abord celui de Free, puis rapidement la plupart des autres box du marché) et ayant pour principales thématiques le jeu vidéo et la culture japonaise.
Si le premier a déjà droit à de petites fenêtres irrégulières sur nos télévisions, il est indéniable que son traitement général est indigne de la place qu’occupe ce loisir de nos jours. Quant au second, son exposition est pour ainsi dire inexistante dans nos médias, en dépit de la fascination que le pays du Soleil Levant exerce sur notre jeunesse depuis plus de vingt ans, prenant ainsi la place que les États-Unis ont longtemps occupée en tant que « pays qui fait rêver ». Nolife affiche donc dès le départ la volonté de faire découvrir le Japon loin des clichés habituellement véhiculés (l’expression « entre tradition et modernité » est totalement proscrite) et de traiter le jeu vidéo aussi sérieusement qu’on pourrait le faire pour le cinéma, la musique etc.
Sur le papier, ces intentions louables font diablement envie, mais qu’en est-il une fois affichées à l’écran ?
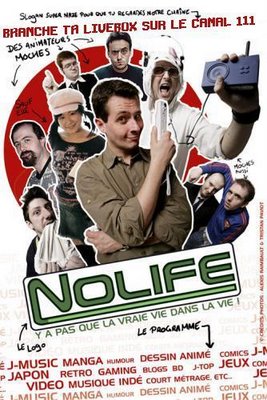
L’une des premières publicités pour la chaîne et déjà, le ton est donné.
Autant prévenir le néophyte que vous êtes peut-être : le premier contact avec Nolife est souvent un peu rude. Peut-être tomberez-vous sur un de ces clips où de jeunes japonaises de quatorze ans entonnent leur pop acidulée dans des ambiances dignes d’un trip de bisounours sous LSD (les fameuses idols) ? Ou bien aurez-vous la chance de découvrir une de leurs émissions présentées par des animateurs « moches » (ça n’est pas moi qui le dit, c’est eux), qui lisent leurs notes devant la caméra ou improvisent joyeusement ? Mais ne vous arrêtez surtout pas à cette première sensation car vous risqueriez de passer à côté de quelque chose de vraiment intéressant.
Tout d’abord, l’amateurisme apparent de la chaîne n’est qu’une émanation volontaire du ton désiré par S. Ruchet et A. Pilot pour leur bébé, à savoir « ne pas faire télé ». Casser, se jouer des codes habituels de la télévision. Ce que votre serviteur traduit volontiers par un vulgaire mais très explicite « ne pas prendre le téléspectateur pour un con ». Certes, les animateurs n’ont pas le sourire ultra-bright, les émissions semblent être réalisées avec trois bouts de ficelle, mais bon sang ! Que le résultat est impressionnant de professionnalisme en dépit de ces limitations et surtout, tous les intervenants maîtrisent leurs sujets ! Une qualité bien trop rare à mon goût ces derniers temps à la télévision. À part peut-être dans les émissions de télé-réalité où les gens rivalisent d’ingéniosité pour élever la bêtise et l’humiliation aux rangs d’arts … Mais je m’égare !
Pour vous donner un exemple, ailleurs, là où la présentation jeu vidéo n’a généralement droit qu’à une pastille de trois minutes (avec cette habitude super désagréable de couvrir la bande-son du jeu par de la soupe Rap/R’n’B/Rock FM « tu comprends, il faut attirer le d’jeuns coco ! »), Nolife n’hésite pas à dépasser régulièrement les dix minutes pour une critique. Voire bien plus pour les gros titres. Et là encore, le ton employé se veut délicieusement décalé, irrévérencieux, mais toujours extrêmement rigoureux et informatif.
Autre qualité : la transparence voulue par la chaîne. Celle-ci se traduit par un soucis constant d’information quant aux coulisses des émissions ou des divers incidents qui jalonnent sa jeune histoire. Il n’est donc pas rare de voir les animateurs, mais aussi les techniciens ou stagiaires, apparaître à l’écran pour expliquer le fonctionnement de la chaîne, le « pourquoi du comment » du retard de telle ou telle émission.
Néanmoins, les haters reprochent souvent à Nolife la supposée trop grande place faite à la musique japonaise sur l’antenne. Tout d’abord, c’est oublier que Nolife est avant tout aux yeux du CSA une chaîne musicale et est donc dans l’obligation d’ouvrir une partie de son antenne à la musique à des horaires fixes. Celui qui veut voir du jeu vidéo sait à quelle heure il doit allumer son poste. C’est aussi faire preuve de bien de mauvaise foi tant Nolife a préféré ne pas s’engager dans la tranchée mille fois creusée par nombres d’autres chaînes musicales (diffusant toutes la même douzaine de clips faits au choix de R’n’B de supermarché ou de variété qui n’a de variée que le nom) en laissant la place aux indépendants, ces artistes qui ne jouissent pas de l’exposition d’une major, mais aussi évidemment à la musique japonaise. D’ailleurs, il est complètement idiot de résumer la scène musicale japonaise aux exemples régulièrement cités par les critiques de la chaîne tant le Japon se révèle être extrêmement riche en courants musicaux. Rock, rap, chanson … Il y en a tout simplement pour tous les goûts et certains artistes nippons se montrent certainement bien plus inspirés et audacieux que bon nombre des « stars » occidentales. Allez, comme je me sens d’humeur partageuse, je vous donne quelques-uns de mes coups de cœurs découverts grâce à Nolife : Kokia, One Ok Rock, Kishidan, Polysics …
Mais Nolife, c’est aussi un accouchement dans la douleur, plusieurs années de vaches maigres, une mort programmée plusieurs fois évitée de justesse.
Si, en 2007, la chaîne dispose d’une mise de départ ridicule comparée aux géants de la télévision, ses papas espèrent la financer à partir de la publicité. Problème, pour qu’il y ait réclame, il faut qu’il y ait audience. Hors, si au bout de quelques mois, Nolife jouit d’une belle réputation dans les milieux geeks, impossible de connaître le nombre de téléspectateurs réguliers car Médiamétrie (l’organisme chargé de mesurer les audiences en France) n’effectue pas de mesure sur les réseaux ADSL. A ce titre, l’histoire de la chaîne n’a rien à envier à bien des tragédies tant le serpent de mer que représente la question des audiences a le chic pour pointer son nez à chaque fois que la santé de la chaîne semble s’améliorer.
Si la société Ankama a pu temporairement sauver la mise à la petite chaîne, cette dernière a aussi pu souffler sa cinquième bougie grâce à ses téléspectateurs. A l’été 2009, voyant que la chaîne risque de ne pas pouvoir faire sa rentrée, l’équipe décide de faire un pari très audacieux en lançant sur son site Nolife-Online. Ce système permet d’avoir accès à toutes les émissions de la chaîne depuis sa création (et il y en a déjà un sacré paquet à l’époque et encore plus aujourd’hui) monnayant une petite somme, ou un abonnement, suivant la formule désirée. Là où le pari est gonflé, c’est qu’il est décidé que Nolife restera tout de même gratuite sur les réseaux ADSL. « Mais alors ? » vous demandez-vous. « Qui irait payer pour visionner sur son ordinateur ce qu’il peut déjà voir gratuitement sur son téléviseur ? » Et bien plus de monde que vous ne pouvez le penser figurez-vous ! En effet, beaucoup de téléspectateurs de Nolife ont décidé de soutenir leur chaîne préférée en faisant chacun un geste à la hauteur de leurs moyens. Certes, bien que les abonnements se soient montrés souvent irréguliers, insuffisants, et s’ils n’ont pas à eux seuls permis à Nolife de poursuivre son chemin sereinement, ils lui ont servi de bouée de sauvetage en attendant que la publicité arrive enfin. Cette vague de soutien a surtout eu (et a toujours d’ailleurs) le mérite d’exposer la formidable communauté que constitue les spectateurs fidèles de Nolife.

Un des grands moments de la soirée anniversaire des cinq ans : la présence de Yamaoka san. Le musicien connaît bien l’équipe de Nolife pour avoir déjà composé pas mal de jingles ou de génériques.
Aujourd’hui, si tout n’est pas encore tout rose, les mesures d’audience ont enfin commencé. Le staff de Nolife a pu découvrir des chiffres particulièrement encourageants et prometteurs, et a pu décrocher ses premiers contrats publicitaires synonymes de rentrée d’argent. Durant tout ce temps, malgré les difficultés financières et les doutes qui ont assaillis la jeune chaîne depuis sa création, jamais l’inventivité n’a été en berne. Les fidèles vous le diront : en dépit de moyens très limités (et c’est peu de le dire), jamais les équipes de S. Ruchet et A. Pilot n’ont cessé de proposer de nouveaux programmes, qui plus est originaux et diablement intéressants par rapport à la concurrence. On se prend donc à rêver de ce dont ils peuvent être capables avec plus de moyens
Pour résumer, on pourrait écrire que Nolife dispense des programmes à l’intelligence inversement proportionnelle à ses moyens. En espérant que ce dernier soucis soit définitivement réglé dans un avenir très proche.
Nolife Story ou les coulisses de la chaîne
Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons revenir au sujet principal de cet article. Que raconte Nolife Story ? Comme son titre l’indique, l’ouvrage de F. Gorges revient sur l’histoire de Nolife.
« Non sans déconner ? T’as trouvé ça tout seul ? »

Sébastion Ruchet, un « Red Fromage » particulièrement ému à soirée des cinq ans.
Hem … Évidemment, s’il est question des cinq premières années de « la petite chaîne qui monte », sa gestation et les histoires personnelles de ses deux principaux initiateurs sont certainement les points les plus pertinents du livre. Loin de moi l’envie de faire croire que la chronique de la période 2007-2012 ne soit pas intéressante. Pas du tout ! Mais les téléspectateurs fidèles (dont je fais partie) et encore plus les membres de son forum connaissent déjà sur le bout des doigts les péripéties par lesquelles la petite équipe a du passer. Par le biais d’émissions comme Debug Mode (la rubrique making of de la chaîne) ou le Point sur Nolife (pastille destinée à informer les téléspectateurs sur la santé de la chaîne).
Avant d’aborder le cas de Nolife, F. Gorges a tenu logiquement à se pencher d’abord sur les histoires de S. Ruchet et A. Pilot. Ne comptez pas sur moi pour vous en faire un résumé, vous n’avez qu’à acheter le livre ! Mais, comme c’est souvent le cas dans nombre de success story (non, non, cette expression n’est pas exagérée ici), on retrouve dans leurs jeunes années le ferment qui donnera naissance à la chaîne bien des années plus tard : le jeu vidéo évidemment ; les manga et animes qu’ils découvrent par le biais des boutiques d’import ; les conventions où les passionnés se rendent, font connaissance, gardent contact … A ce titre, on s’aperçoit que, déjà à l’époque, gravite autour des deux personnages un petit noyau de personnes qui les rejoindront aussi dans l’aventure Nolife.

Alex Pilot, à Japan Expo
Sans trop en dévoiler, la jeunesse d’Alex Pilot devrait résonner en pas mal de fans de manga et d’animes tant il était difficile d’assumer dans les années 80/90s cette passion. Son passage à Game One apparaît également comme extrêmement difficile pour le jeune homme timide qu’il est. Bosseur, imaginatif, si son intégration dans l’équipe de la première chaîne jeu vidéo de France est compliquée, force est de constater que son travail est déjà reconnu. Et défendu par « son parrain en télé », Patrick Giordiano (aka Matt Murdock de Player One, Télévisator 2 …). Ce dernier se place comme l’éminence grise, le référent, celui qui encourage les deux hommes dans leurs projets sans leur cacher les embûches qu’ils vont rencontrer en chemin.
Évidemment, sont aussi évoqués les épisodes Bitoman, la première série d’Alex ; Pocket Shamui, la société de production de reportages créée par Alex et Seb ; sans oublier France Five.
Mais revenons-en à Nolife. Si la chaîne est apparue sur le réseau Free le 1er juin 2007, l’idée de celle-ci a émergé dans les esprits dès la fin 2006. Après avoir zappé sur les dizaines de chaînes que propose Free (essayez, on tombe parfois sur des trucs hallucinants), les deux compères s’informent et se rendent compte qu’il semble relativement facile de créer une petite chaîne (on verra par la suite qu’en fait, non). Tout va alors très vite : les prises de contact avec les instances, les amis et/ou personnes rencontrées lors de conventions susceptibles d’être intéressés par les thématiques de la future chaîne et de proposer du contenu.
A commencer par le nerf de la guerre : l’argent.
Car, aussi passionnés qu’ils puissent être, il leur faut réunir une mise de départ afin de pouvoir concrétiser leur rêve. Et c’est là qu’on s’aperçoit que Nolife, c’est aussi une formidable histoire d’amitié car S. Ruchet et A. Pilot ont pu compter sur leur entourage afin de récolter la somme nécessaire au financement de leur projet et permettre le lancement de la chaîne en mars 2007. « Attends là, on n’a pas dit au début que la chaîne avait commencé à émettre en juin 2007 ? » Et voilà que Nolife n’existe pas encore que déjà les déconvenues commencent … Suite à des malentendus, des coups de fil dans le vent et aussi, Alex et Seb le reconnaissent volontiers, à pas mal d’inexpérience et de naïveté, l’équipe va attendre pendant trois mois l’autorisation d’émettre. Et lorsque Nolife arrive enfin, ses économies sont déjà presque à sec. En clair, si personne ne remet la main à la poche, la chaîne sera morte née. Et voilà que les mêmes copains se dévouent.
N’y voyez aucune mauvaise intention de ma part, mais si on parle souvent de Nolife comme le résultat du travail acharné de gens passionnés qui ne comptent pas leurs heures, il faut quand même reconnaître que, dans leur malheur, S. Ruchet et A. Pilot ont eu la « chance » d’être entourés de personnes et d’amis suffisamment motivés pour sacrifier une partie de leurs économies dans un projet sur lequel beaucoup n’auraient pas misé un kopeck. A ce titre, la question de l’argent est régulièrement abordée tout au long du livre, sans tabou. Salaires, stagiaires, coûts de productions… Sans en faire des tartines, S. Ruchet et A. Pilot apparaissent comme réellement préoccupés par ce point, pour la survie de la chaîne évidemment, mais surtout pour une juste rémunération de leurs employés, à hauteur du travail phénoménal accompli depuis tout ce temps.
Mais Nolife Story ne donne pas la parole qu’à Seb et Alex, mais aussi à plusieurs intervenants réguliers de Nolife : Davy, Medoc, Thierry Falcoz, Julien Pirou … Impossible de tous les citer mais F. Gorges a tenu à recueillir les témoignages de ceux qui participent à l’aventure depuis le début ou l’ont rejointe en cours de route. Bien que trop rares à mon goût, ces commentaires permettent de voir le fonctionnement de la chaîne selon d’autres points de vue. C’est aussi l’occasion d’anecdotes savoureuses sur « l’intimité » de l’équipe. Votre serviteur n’a pu s’empêcher d’éclater de rire en découvrant la méthode employée par Davy Mourier pour décoincer son stagiaire d’alors chez les éditions Kaze, à savoir Julien Pirou. L’ouvrage se conclue d’ailleurs sur une table ronde durant laquelle sont évoquées les galères passées, mais aussi les envies, les perspectives, les espoirs.
« Ce que le public te reproche, cultive-le, c’est toi .» C’est par cette citation de Jean Cocteau que s’ouvre le premier chapitre de Nolife Story. On ne pourrait pas mieux résumer le leitmotiv des gens qui font tous les jours cette chaîne. Sans se soucier du « qu’en dira-t-on ? », l’équipe trace sa voie et est en marge de réussir son pari de rendre viable une chaîne au contenu exigeant, voire segmentant, sans céder aux diktat de l’industrie télévisuelle. Dans un esprit nekketsu très proche de sa biographie de Yoshihisa Kishimoto, l’ouvrage de Florent Gorges retrace avec minutie et force d’anecdotes les hauts et les bas qui jalonnent l’histoire de la jeune chaîne. Si le fan connaît déjà les grands et les petits épisodes de Nolife, il est certain qu’il trouvera plaisir et émotions à les revivre en parcourant le livre. Quant à ceux qui ont découvert la chaîne récemment et qui ne peuvent déjà plus en décoller, je ne peux que vous conseiller de vous procurer Nolife Story et, évidemment, de vous abonner à Nolife Online pour découvrir les débuts de vos émissions et animateurs favoris. « Il n’y a pas que la vraie vie dans la vie » dit le slogan de la chaîne. Non, il y a la passion aussi.

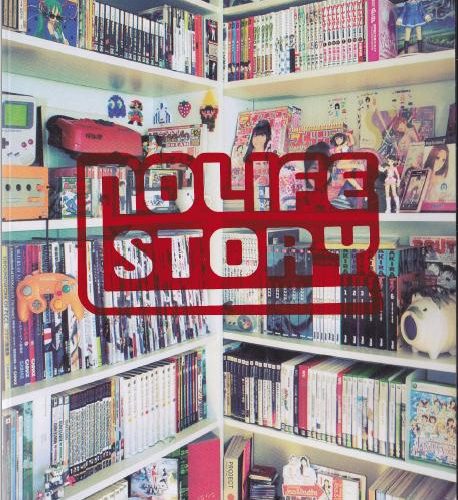
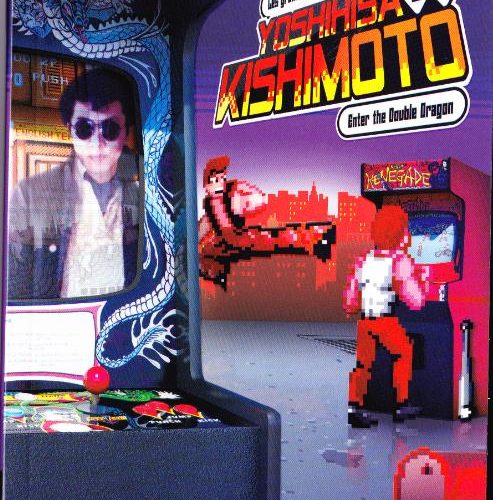
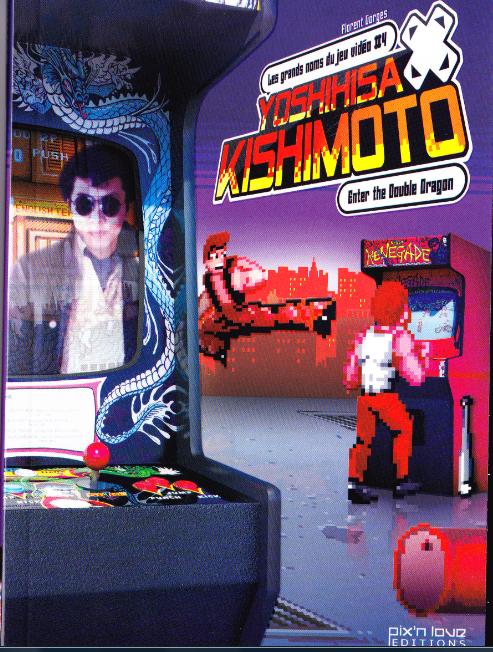

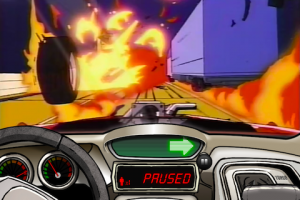
 C’est ainsi que va naître Nekketsu Kôha Kunio Kun (Renegade en occident), jeu de baston inspiré des bagarres de ces années lycée et première pierre d’un genre que l’on appellera bientôt beat’em up. On tient aussi là ce qui est certainement le premier jeu autobiographique tant l’histoire, les personnages, mais également les moindres détails graphiques renvoient à la réalité des bandes de voyous japonais. Pour l’exemple, dans le jeu original (c’est-à-dire dans sa version japonaise), les poignées des cartables de certains personnages sont blanches. Ce choix ne doit rien au hasard et je vous laisse chercher sa signification …
C’est ainsi que va naître Nekketsu Kôha Kunio Kun (Renegade en occident), jeu de baston inspiré des bagarres de ces années lycée et première pierre d’un genre que l’on appellera bientôt beat’em up. On tient aussi là ce qui est certainement le premier jeu autobiographique tant l’histoire, les personnages, mais également les moindres détails graphiques renvoient à la réalité des bandes de voyous japonais. Pour l’exemple, dans le jeu original (c’est-à-dire dans sa version japonaise), les poignées des cartables de certains personnages sont blanches. Ce choix ne doit rien au hasard et je vous laisse chercher sa signification …
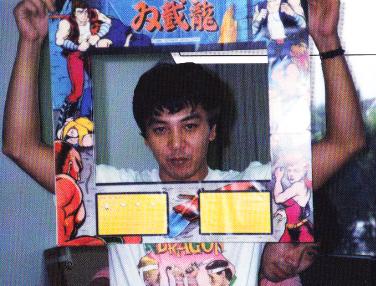 Inutile de s’étendre sur la franchise vedette de Technos Japan. Non que son histoire ne soit pas intéressante, bien au contraire : le livre de Florent Gorges regorge d’anecdotes sur le développement des aventures des frères Lee et leurs suites. Anecdotes dont tout fan de jeux vidéo et de rétrogaming ne peut que se délecter. Mais, si Yoshihisa Kishimoto n’est malheureusement pas connu à la hauteur de sa contribution au monde vidéoludique, c’est qu’on devine les aléas de sa carrière chez Technos : un jeu qui fait un tabac ; un suivant qui enfonce le clou et une entreprise qui, grisée par la réussite, se fourvoie dans des suites allant de l’excellent (Double Dragon 2) au médiocre (Double Dragon 3), finissant par tuer la poule aux œufs d’or, pendant que la concurrence copie et magnifie le concept original : c’est à ce moment que vous devez tous penser en chœur au Final Fight de Capcom. Mal gérée, incapable de se doter d’un véritable pôle de recherche et développement au grand dam de Kishimoto, Technos Japon finit par lasser le public et met la clé sous la porte.
Inutile de s’étendre sur la franchise vedette de Technos Japan. Non que son histoire ne soit pas intéressante, bien au contraire : le livre de Florent Gorges regorge d’anecdotes sur le développement des aventures des frères Lee et leurs suites. Anecdotes dont tout fan de jeux vidéo et de rétrogaming ne peut que se délecter. Mais, si Yoshihisa Kishimoto n’est malheureusement pas connu à la hauteur de sa contribution au monde vidéoludique, c’est qu’on devine les aléas de sa carrière chez Technos : un jeu qui fait un tabac ; un suivant qui enfonce le clou et une entreprise qui, grisée par la réussite, se fourvoie dans des suites allant de l’excellent (Double Dragon 2) au médiocre (Double Dragon 3), finissant par tuer la poule aux œufs d’or, pendant que la concurrence copie et magnifie le concept original : c’est à ce moment que vous devez tous penser en chœur au Final Fight de Capcom. Mal gérée, incapable de se doter d’un véritable pôle de recherche et développement au grand dam de Kishimoto, Technos Japon finit par lasser le public et met la clé sous la porte.









 Le principal grief, et certainement le plus rédhibitoire pour les détracteurs du film, tient en son ton très « américain » dans ce que cela a de péjoratif. Comprenez, que ça soit dans l’utilisation de plans de coupe venant souligner grossièrement les propos (ville sous la pluie, plage déserte …), de gros plans sur les visages, de la superbe mais néanmoins trop discrète partition de Jim Guthrie accompagnant certaines confessions très intimes. Certaines séquences ont même visiblement été mises en scène spécialement pour le film (je pense particulièrement à celle de Fish au fond de la piscine). Très photogéniques, elles n’en demeurent pas moins artificielles, se contentant surtout de forcer le traits à des moments qui n’en avaient déjà pas besoin. En ce sens, Lisanne Pajot et James Swirsky tirent un peu trop maladroitement sur la corde du pathos. Au mieux, on se sentira concerné, au pire, consterné.
Le principal grief, et certainement le plus rédhibitoire pour les détracteurs du film, tient en son ton très « américain » dans ce que cela a de péjoratif. Comprenez, que ça soit dans l’utilisation de plans de coupe venant souligner grossièrement les propos (ville sous la pluie, plage déserte …), de gros plans sur les visages, de la superbe mais néanmoins trop discrète partition de Jim Guthrie accompagnant certaines confessions très intimes. Certaines séquences ont même visiblement été mises en scène spécialement pour le film (je pense particulièrement à celle de Fish au fond de la piscine). Très photogéniques, elles n’en demeurent pas moins artificielles, se contentant surtout de forcer le traits à des moments qui n’en avaient déjà pas besoin. En ce sens, Lisanne Pajot et James Swirsky tirent un peu trop maladroitement sur la corde du pathos. Au mieux, on se sentira concerné, au pire, consterné.




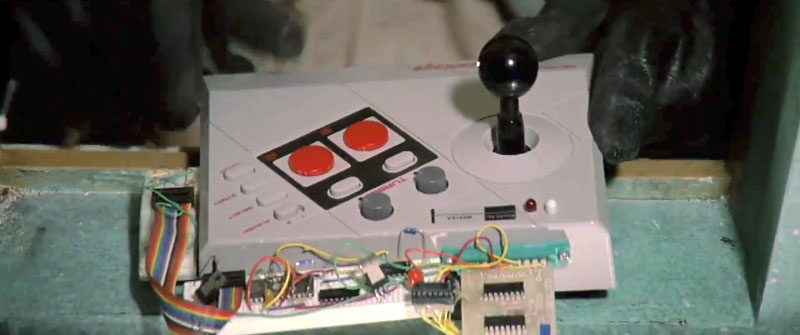


 La chambre de You. Vous devrez y revenir très souvent. Notez la présence de la radio
La chambre de You. Vous devrez y revenir très souvent. Notez la présence de la radio Pour vivre heureux, vivons cachés ?
Pour vivre heureux, vivons cachés ? Vous croiserez des survivants dans des scènes qui ne sont pas sans évoquer les films de David Lynch.
Vous croiserez des survivants dans des scènes qui ne sont pas sans évoquer les films de David Lynch. Ça n‘en a pas forcément l’air, mais il s’agit bien de votre cuisine
Ça n‘en a pas forcément l’air, mais il s’agit bien de votre cuisine Un type avec une tête cubique, ça ne vous fait pas penser à quelqu’un d’autre ?
Un type avec une tête cubique, ça ne vous fait pas penser à quelqu’un d’autre ? Le plan du premier étage. Evidemment, au tout début, il n’y a pas autant d’indications.
Le plan du premier étage. Evidemment, au tout début, il n’y a pas autant d’indications. Pas besoin d’y voir clair pour comprendre qu’il va falloir courir.
Pas besoin d’y voir clair pour comprendre qu’il va falloir courir.